Mardi 13 avril - L’évaluation : un dispositif de domination ou d’émancipation ? (Fondation Gabriel PERI)
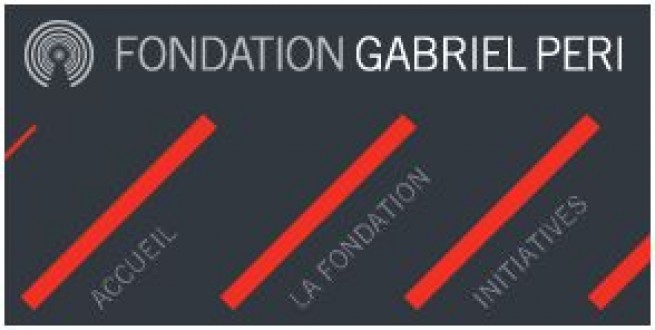
Mardi 13 avril 2010, de 19h à 21h
L’évaluation : un dispositif de domination ou d’émancipation ?
Avec Roland Gori, psychanalyste, professeur de psychologie et de psychopathologie à l’université d’Aix-Marseille, initiateur de « L’Appel des appels ».
Lieu : Espace Niemeyer,
6 avenue Mathurin Moreau (Paris)
(plan d’accès)
Mise en bouche :
Nous sommes dans une société de « l’évaluation généralisée » où le gouvernement prétend soumettre à ce dispositif jusqu’à l’action politique des Ministres eux-mêmes. C’est au nom de la nécessité de « rendre des comptes » à la nation que s’est subrepticement installé un « appareil » de gouvernement dont on peut actuellement se demander si sa promotion est le fait d’une « transparence » démocratique ou l’opérateur de toutes les impostures ? Dans les métiers du soin, de la recherche, de la justice, de l’enseignement, de la culture, de l’information, du travail social, de la police, etc., on ne parle que de « tarification à l’activité » et « d’indicateurs quantitatifs ». Sommes-nous face à une nouvelle civilisation des mœurs, un nouvel art de gouverner qui conduit à un totalitarisme « light » auquel le Pouvoir soumet en douceur les individus et les populations ? L’évaluation quantitative n’est-elle pas une manière de transformer les actes des métiers en marchandises et les individus en « choses » ? Peut-on aujourd’hui redonner à l’évaluation la « valeur » politique et anthropologique qui était la sienne à l’origine, dans par exemple la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789 ?
L’objectif global de ce séminaire est de réfléchir à ce que pourrait être un nouveau type de développement qui sorte des ornières dans lesquelles nous a jeté l’actuel mode de croissance capitaliste. Mais ce séminaire entend aborder cette problématique en suivant trois axes de réflexion.
Le premier s’interrogera sur ce qu’on peut entendre par développement lorsqu’on le rapporte aux personnes, aux sociétés et à l’humanité tout entière -sur notre planète aux ressources et aux capacités d’absorption de nos rejets limitées- à leurs besoins, vitaux comme à ceux, tout aussi vitaux, qui se rapportent au processus d’individuation, au regard des potentialités d’une époque. A partir de là, c’est-à-dire à partir de ce que nous pourrions cerner comme finalités humaines à assigner au développement, nous souhaiterions contribuer à dégager une autre vision de ce qu’est la richesse pour une société et pour l’humanité, de ce qu’il est souhaitable qu’une société vise en priorité pour favoriser l’épanouissement de ses membres. Or les notions de croissance ou de développement tel quelles sont comprises communément aujourd’hui, occultent totalement cette problématique complexe du sens, des moyens et des fins des sociétés humaines pour la recouvrir par la réponse dominante, à savoir et schématiquement : produire pour accumuler du capital, au coût que l’on sait pour les peuples et pour la planète. Et c’est le résultat de ce processus qui passe massivement pour faire richesse dans nos sociétés. Marx évoquait déjà d’autres pistes pour concevoir ce qui fait richesse en société lorsqu’il écrivait dans les « Grundrisse » que « la richesse réelle est la force productive développée de tous les individus » autrement dit l’essor de leurs capacités d’intervention sur le monde et, dès lors, que « le temps disponible (…) est la mesure de la richesse » et non plus la seule valeur d’échange adossée au temps contraint. Ce qui peut nous conduire à envisager la problématique du développement sous un tout autre angle …
Le second cherchera à identifier ce qui peut-être les conditions et les moyens d’un autre type de développement, en appui sur des services publics, des biens communs universels, l’économie sociale et solidaire - dont les acteurs doivent nécessairement s’interroger sur leur place au sein d’un mouvement de transformation sociale et sur la conception qu’ils en ont- l’autogestion... comme possible socle d’un autre fonctionnement d’une économie fut-elle marchande, dès lors que les finalités des activités de production de biens et de services soient au service prioritaire du développement des hommes dans leur environnement naturel et cultivé.
Le troisième axe s’efforcera de réfléchir sur les questions liées à la mesure de la richesse produite en relation avec les points précédents, c’est-à-dire à celle des indicateurs/incitateurs à créer ou mettre en place, en complément ou en substitution à ceux existant actuellement, pour qu’ils s’accordent aux fins émancipatrices d’un nouveau type de développement.
SOURCE
http://www.gabrielperi.fr/-Quel-nouveau-type-de-developpement-

