NOUVEAU RÉALISME, NOUVELLE MONNAIE: L’ÉCONOMIE DES SIGNES DANS "L’IMPRÉCATEUR" DE RENÉ-VICTOR PILHES - par Nathalie Buchet Rogers Wellesley College
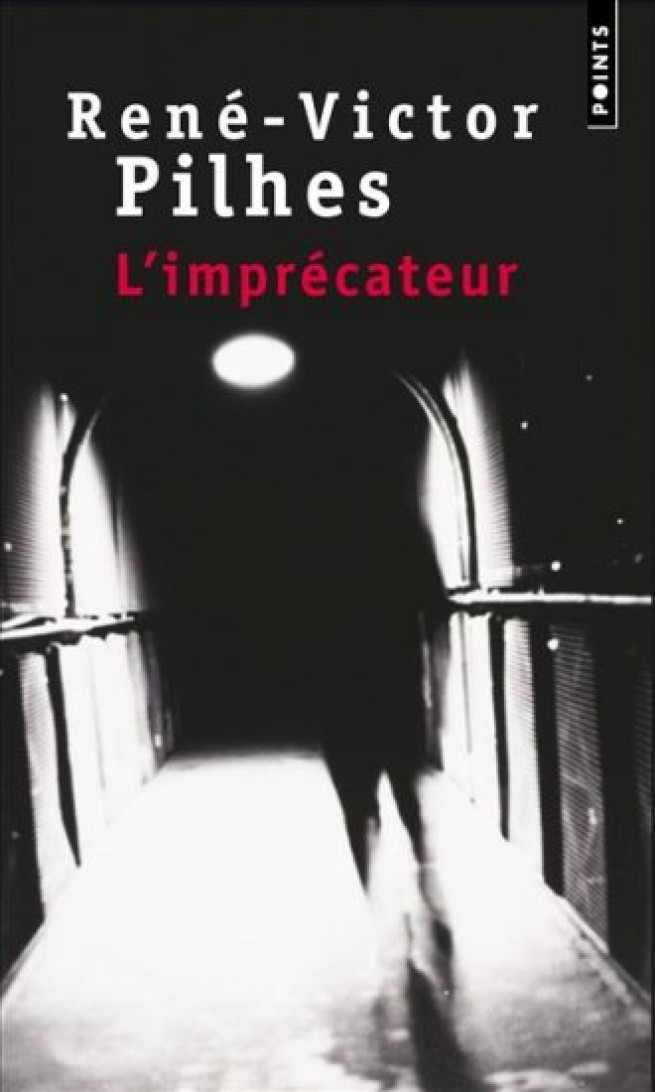
L’Imprécateur de René-Victor Pilhes, prix Médicis 1974, a pour cadre un espace assez étrange, l’univers technocratique et fort peu “romanesque” du capitalisme multinational. Dès la première page, le narrateur annonce ainsi son projet:
Je vais raconter l’histoire de l’effondrement et de la destruction de la filiale française de la compagnie Rossery & Mitchell, dont l’immeuble de verre et d’acier se dressait naguère à Paris, au coin de l’avenue de la république et de la rue Oberkampf, non loin du cimetière de l’Est. (Pilhes 5)
Très rapidement, les problèmes se précipitent au sein de cette compagnie qui est cependant “la plus grande entreprise que le monde ait connue”: un jeune cadre se tue dans un accident de la route, une fêlure menace les fondations de l’immeuble, et surtout, de mystérieux “rouleaux” font leur apparition sur les bureaux du personnel, semant le trouble, puis la panique dans les esprits. Malgré leur caractère hétérogène, les événements apparaissent comme liés dans l’esprit du narrateur. Pour lui, le nœud du problème se situe dans une faille structurelle qui menace l’existence même de la société de consommation “postindustrielle” (194). Cette menace de déstabilisation touche à la fois le système économique et le domaine du langage. Cette relation est exprimée dans une curieuse équation qui mérite de retenir notre attention:
Depuis le début de cette incroyable affaire, le langage subissait d’inexplicables déprédations. Au fond, plus le cash-flow se portait bien, plus le langage se dété-riorait. Voilà qui me parut hautement symbolique du sens qu’il convenait d’attribuer à l’ensembles des événements et, sans doute, de la moralité qu’il faudrait tirer plus tard de l’histoire. (227)
C’est cette “moralité,” et les termes de cette équation que je me propose d’étudier. Pilhes semble en effet nous donner ici l’un des rares romans récents qui centrent la problématique de leur action sur les interactions des phénomènes de langage et de monnaie. En fait, l’étude de ce roman va nous permettre de percevoir un nouveau cas de figure dans le statut des équivalents généraux qui président aux échanges et à la circulation des signes monétaires et des signes linguistiques, tels que les a décrits Jean-Joseph Goux dans Les Monnayeurs de langage. L’Imprécateur nous met en face d’une rupture structurale supplémentaire qui correspond à une nouvelle étape de l’histoire du capitalisme occidental. Ce sont les tenants et les aboutissants de cette nouvelle situation qu’il s’agit de définir.
L’univers des sociétés multinationales est sans aucun doute symptomatique de l’évolution ultime du capitalisme, tout au moins tel qu’il apparaît aujourd’hui. Cette nouvelle étape est décrite par de nombreux ouvrages sur la périodisation historique du capitalisme occidental, qui tous s’accordent pour reconnaître qu’un phénomène nouveau est apparu au lendemain de la seconde guerre mondiale. Dans Late Capitalism, Ernest Mandel qualifie cette nouvelle étape de “troisième révolution technologique” et date ainsi son avènement: “The inception of the use of electronic data-processing machines in the private sector of the Americam economy in 1954” (Mandel 194). Selon Mandel, ce troisième moment marque le dépassement des frontières nationales dans l’expansion du capital, dans le cadre de firmes multinationales. C’est bien le mouvement que l’on observe chez Pilhes et que décrivent les premières pages du livre (7–8). La politique d’expansion de la firme détermine un nivellement des différences: partout dans le monde où s’implante la compagnie s’élèvent les mêmes immeubles de verre et d’acier qui marquent la mort de l’exotisme.
La périodisation de Mandel s’accorde avec celle que décrit Lucien Goldmann dans Cultural Creation, tout au moins dans ses trois dernières étapes. Goldmann distingue en effet quatre périodes dans l’histoire du capitalisme, et retrace une évolution parallèle des phénomènes artistiques et en particulier littéraires, qui souligne l’interdépendance des structures économiques et de la création artistique. Il lie ainsi, dans une première phase, la transition de l’économie libérale à celle des cartels et des monopoles à la dissolution concommittante du personnage romanesque, puis dans un second mouvement, l’apparition du capitalisme organisationnel à celle du Nouveau Roman. La première transition est caractérisée en particulier par les œuvres de Sartre, de Joyce, Camus, Kafka et Becket: la dissolution du personnage et la disparition de la notion de “héros” y reflètent l’abandon contemporain, dans le domaine économique, de l’autonomie individuelle comme valeur universelle. Cette “dissolution du héros,” accompagnée d’une crise économique grave, a pour corollaire un sentiment de malaise et d’angoisse, une conscience aiguë de l’absurde qui se retrouve aussi dans la philosophie existentialiste. La seconde transition, elle, est marquée par une relative stabilisation de l’économie, qui se traduit dans le Nouveau Roman par une disparition de l’angoisse, tandis que la dissolution du personnage se poursuit. Ainsi se précise un processus de radicalisation qui selon lui: began with the novel of the problematic hero, continued in existential philosophy and the novel of the dissolution of character in a decomposed, anguished world, and issued in the reappearance of a stable, balanced, but rigorously ahuman universe. (Goldmann 82–86)
Bien que le roman de Pilhes ne puisse se ranger sous l’étiquette de Nouveau Roman, il est néanmoins symptomatique de cette dernière étape décrite par Goldmann. Le manque total de responsabilité individuelle au sein de la société technocratique moderne est en effet tout à fait caractéristique de l’atmosphère de L’Imprécateur. Pierre Grou souligne également de son côté le processus de “dilution de la propriété individuelle” qui caractérise le développement du capitalisme depuis ses origines. A partir de 1965, il n’y a plus d’appropriation économique individuelle; . . . la direction est collective et demande un ensemble de fonctions spécialisées à la tête de l’entreprise; l’organisation diversifiée de la “technostructure” engendre un groupe de dirigeants, les technocrates qui s’approprient collectivement le capital; la classe dominante devient la technocratie. (Grou 110)
Nous reconnaissons ici le portrait des cadres d’état-major technocrates, les douze membres du “staff” de l’entreprise Rossery & Mitchell France. L’analyse de Grou s’accorde avec celle de Mandel et vient encore renforcer celle de Goldmann, en confirmant la dissolution de l’individualité. La crise de la propriété financière individuelle entraîne une crise du sujet. Cette caractéristique est présente chez Pilhes. En effet, aucun des douze membres du “staff” de l’entreprise ne semble avoir une personnalité marquée. Ils sont au contraire, semble-t-il, parfaitement interchangeables: ils étaient tous des cadres d’état-major, des cadres du staff pour reprendre le terme des théoriciens de l’époque, tous salariés par Rossery & Mitchell, tous semblables, sachant et ignorant à peu près les mêmes choses, promis au même type de réussite, soumis aux mêmes aléas, rapidement bloqués par les mêmes limites. (Pilhes 47)
Le malaise vient aussi du fait que le seul critère de définition de l’individu est un critère économique. Les sujets sont définis par les concepts économiques qu’ils représentent, ce qui accentue encore le mouvement que suggérait Gide dans Les Faux-monnayeurs. Dans ce roman, Edouard ressentait en effet la contagion des phénomènes économiques dans l’univers de son roman, au point que ses personnages étaient remplacés par des concepts financiers: “Les idées de change, de dévalorisation, d’inflation peu à peu envahissaient son livre, comme les théories du vêtement de Sartor Resartus de Carlyle—où elles usurpaient la place des personnages” (Gide 189). C’est bien se qui se passe chez Pilhes, et ce de façon encore plus radicale. Dans un tel contexte, et pour reprendre une analyse de L’Homme sans qualités de Musil, l’argent n’est plus seulement la mesure universelle de la valeur des marchandises, mais aussi la commune mesure qui permet de régler l’ensemble des relations humaines, et qui constitue l’étalon idéal de toutes les activités. (Goux,Les Monnayeurs 164)
Dans ce monde, la fonction de directeur des relations humaines ne peut être que marginale et, de plus, une parodie de ce qu’elle devrait être. Le narrateur, qui occupe une telle position, semble d’ailleurs, et surtout au début, plus désireux de préserver son “haut salaire” et sa position vis-à-vis de la direction, que de réellement améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. Quant à l’ensemble des cadres, ils ne reculent devant aucune compromission lorsqu’il s’agit de préserver leurs émoluments. Cette situation sera poussée à l’extrême par Pilhes, puisque le cadre Le Rantec ira jusqu’à tuer un de ses collègues contre la promesse d’obtenir la gestion d’une “société holding” (262).
Ce que nous retrouvons ici est bien une version radicale du phénomène de réification que décrit Goldmann. Selon lui, le secteur économique élimine la conscience des valeurs supra-individuelles morales, religieuses ou historiques. Ce processus commence dès la première révolution industrielle, mais ne fait que s’intensifier avec le développement de la consommation de masse (Goldmann 78–79). C’est bien ce qui se passe chez Pilhes, dans un univers “où les pays riches, hérissés d’industries, touffus de magasins, avaient enfin découvert une loi nouvelle, un projet digne des rudes efforts imposés à l’homme et consentis par lui depuis des millénaires: faire du monde une seule et unique entreprise” (114). Dans ce monde, la seule et unique référence devient l’entreprise, car elle seule donne un sens à des activités qui ne se pensent que par rapport à elle. Cet état de chose donne naissance à un humour particulier qui vient de références à première vue saugrenues à des circonstances commerciales lors de l’évocation de moments personnels et chargés d’émotion. Ainsi, devant le corps d’Arangrude, une réflexion du narrateur sur la mort prend cette forme grinçante:
Cela faisait beaucoup de temps que je n’avais eu de contacts avec la mort. Mon dernier défunt était un cousin de mon âge qui s’était noyé au large de Majorque au cours d’une chasse au thon organisée par des fabricants de matériel de camping. (33)
Un décalage s’établit ainsi entre les paroles et les sentiments qui devraient accompagner une situation. A l’annonce de la mort de leur collègue, les cadre font ainsi dévier la conversation sur des détails mercantiles extrêmement précis qui produisent un effet d’humour noir inquiétant:
—De quoi est-il mort au juste? questionna Portal.
—Tempe droite enfoncée . . . collision avec un camion Sotanel.
—Sotanel? dit Brignon, bonne boîte, j’y ai un copain de promotion . . . 6000 F par mois. . . . C’est le quatrième fabricant français de poids lourds.
—Implanté au Benelux, précisa Portal. (29)
La situation économique a donc d’évidentes répercussions sur les phénomènes qui ont trait au langage. Pour les cadres de l’entreprise, le langage financier semble remplacer le langage de l’amour. Madame Arangrude évoque ainsi avec émotion les longues soirées passées avec son mari, alors qu’il apprenait “ce qu’était un chiffre d’affaire, un revenu, une marge, un profit, un investissement” (32). Le langage admis au sein de l’entreprise est un langage “qui sied à un cadre soucieux de concision et de marge commerciale accrue” (112), c’est un langage appauvri et envahi par les signes monétaires. Comme le déclare Abéraud:
Nous sommes tous des hommes qui préférons les carburants des fusées, les instruments de mesure électroniques aux ciboires et aux fétiches. Tous nos symboles sont maintenant mathématiques. (215, je souligne)
La conséquence première semble donc la perte de tout symbolisme verbal et littéraire, la perte de la valeur évocatrice et connotative des mots. Pour McGanter, le président de la multinationale, les hommes ne sont que de petits poteaux, les prairies ne sont que des surfaces du sol qui donnent de l’herbe, les montagnes sont avant tout des pierres et des minerais, la mer n’est jamais qu’un réservoir de sel, d’énergie et de poissons. (205)
C’est également l’imagination qui disparaît du langage des technocrates, leur chant est un chant de guerre, qui . . . remuait les âmes et gonflait les cœurs: ‘Fabriquons, emballons, vendons, et quoi que ce soit!’ . . . Ils avaient perdu leur imagination. (99)
Mais ce qui est avant tout à proscrire dans ce langage, ce sont les effets de style. Tout ce qui de près ou de loin relève de la rhétorique et du langage littéraire est suspect. “C’est curieux ce mal qui semble gagner les meilleurs cerveaux et qui détraque le langage” (183), s’exclame l’expert américain Ronson après une déclaration non orthodoxe du directeur général adjoint Roustev. En effet, ce dernier vient de parler de la fêlure qui menace l’édifice et qui “continue de s’ouvrir, de hideusement serpenter” (182). C’est cette métaphore, qui fait de la fêlure un reptile hideux, qui indispose les représentants américains. Pour eux, il s’agit là d’une “liberté de langage” inadmissible (183). Dans un moment de révolte inspirée au ton apocalyptique, et qui sans doute se réfère de façon oblique aux événements de mai 1968, le narrateur prophétise la fin de ce règne du langage technocratique.
Ecrivains, artistes . . . se réveillèrent et annoncèrent turbulences et complications, convièrent les maréchaux et les spéculateurs tapis derrière leurs tentures d’or à mieux écouter les supplications du verbe enchaîné. (81, je souligne)
Le “verbe enchaîné,” c’est le verbe privé de rhétorique, car pour les technocrates, il s’agit d’un plaisir coupable et pervers. Pour Ronson, il n’y a “aucune raison . . . de parler comme au théâtre, d’abuser de périphrases et de redondances, surtout quand on n’est pas coutumier du fait” (185). A cela, il faudrait ajouter les multiples hyperboles du narrateur: c’est bien de rhétorique et de littérature qu’il s’agit, et tout cela est taxé de propre à faire “verser dans le bucolisme romantique” (185), un langage totalement impropre à la vie de la multinationale.
Que la littérature, et en particulier la poésie, soit visée ne fait pas de doute. Ce n’est sans doute pas un hasard si “l’immeuble de verre et d’acier” est situé “non loin du cimetière de l’Est.” La relation est suggérée plusieurs fois par le narrateur: “Je songeais aux poètes inhumés, au pied de notre forteresse, dans l’enceinte du cimetière de l’Est, ce Père Lachaise” (23). L’entreprise symbolise en effet, la mort de la poésie, et il est significatif que des ossements humains aient été découverts dans les fondations de l’immeuble: ce sont ceux des poètes, romanciers et autres artistes détruits par ce monde mercantile, et si les événements qui secouent l’entreprise ont, selon le narrateur, leur source dans le cimetière, c’est sans doute pour signifier que l’ébranlement de la société postindustrielle proviendra d’une révolte du langage poétique muselé.
La littérature est en effet ouvertement menacée d’extinction dans cet univers technocratique, se dit le narrateur:
Pourquoi ne pas supprimer Montesquieu dans les programmes de nos écoles au profit de l’étude du baril, du demi-baril et de la pinte d’huile de noix de coco?” (208)
A la vérité, l’échange a déjà eu lieu dans la vie des cadres du “staff.” En effet, si l’on en croit les déclarations de sa femme, les lectures d’Arangrude se limitaient à l’étude de “la culture monétaire” (31). La façon dont Saint Ramé, celui qui s’avérera être l’imprécateur, travestit ces faits lors de l’oraison funèbre prononcée sur la tombe du cadre, est significative:
Roger Arangrude passait de longues veillées en compagnie de sa femme et l’un faisait à l’autre, et vice versa, la lecture des poèmes fondamentaux de l’humanité. . . . Il advenait même que certains soirs les époux exerçassent leur sensibilité et leur intelligence sur les textes de jeunes poètes méconnus dont ils s’efforçaient de pénétrer l’univers. . . . Il se repaissait chaque année d’une dizaine de romans modernes, de trois ou quatre ouvrages de politique ou d’économie qu’il annotait soigneusement, il relisait en vacances au moins un grand roman classique. . . . Sa dernière relecture était Guerre et Paix. Où sont les cadres qui ont lu ou, a fortiori, relu ce livre d’une extrême épaisseur? (101)
Bien entendu de telles suggestions sont absurdes, pour reprendre les mots de McGanter; un homme qui a pratiquement inventé en France le marketing de la charcuterie sous cellophane relirait-il donc . . . un grand roman classique? Folie! . . . Qu’ont à voir les soupirs d’Anna Karénine avec les jambons Korvébon? Folie!” (173)
Les cadres de l’entreprise présentent un parfait exemple de la passivité culturelle et intellectuelle engendrée par la société de consommation, et que Goldmann juge si néfaste à la création artistique (85, 88–89). Mais comment comprendre exactement le scandale présenté par la littérature et surtout par la poésie. Certes, le langage littéraire est en principe détaché des buts mercantiles qui gouvernent le monde de l’entreprise: les revenus que l’œuvre peut rapporter à son auteur sont une considération secondaire. Au contraire, chez Rossery & Mitchell, chaque parole est mesurée en fonction des profits qu’elle est susceptible d’entraîner, c’est là le seul critère. Il n’est pas jusqu’à l’oraison funèbre d’Arangrude qui ne soit pensée en terme des bénéfices qu’elle peut procurer à l’entreprise. Ces paroles sont une dépense rentable, un investissement susceptible de rapporter des dividendes et d’être reconverti en espèces avec une “plus-value”; elles sont directement axées sur l’augmentation du “cash-flow,” ce “cœur de l’entreprise,” moteur de toutes les actions. Le problème fondamental, le scandale présenté par le poète est qu’il retire les mots de la circulation habituelle. Ceci est particulièrement visible dans le cas de Paul Valéry. Selon Valéry, il existe une différence fondamentale entre
le mot considéré dans sa fonction d’échange, et le mot pris isolément, comme évocateur d’une signification profonde qu’il est difficile, sinon impossible de définir et d’épuiser. (Goux, Les Monnayeurs 223)
C’est la circulation rapide du mot qui l’appauvrit. Au contraire, le poète
s’appesantit sur le mot, pour en éprouver tous les effets et en accepter l’énigme. Il le soustrait à sa fonction de moyen d’échange, le retire de la circulation pour en éprouver la valeur de retentissement—ce que Valéry nommera . . . “la valeur intrinsèque.” (Goux, Les Monnayeurs 223–24)
Dans ce cas, la poésie interdit que l’on considère les signes linguistiques comme de simples équivalents des signes monétaires “un jeton provisoire qui attend, en principe d’être changé” (Goux, Les Monnayeurs 223–24). Voilà qui constitue une grave infraction aux règles de l’entreprise.
Jamais les cadres ne s’attardent sur la signification des mots qu’ils lancent dans la conversation. Ils se cantonnent généralement aux “lieux communs puisés dans la presse” (192), “ils assaisonnaient le tout d’un vocabulaire anglo-saxon simpliste et faisaient grand cas et grand tapage de l’ensemble” (79). Il s’agit bien de “l’universel reportage” dont parlait Mallarmé, en opposition au langage purement littéraire. C’est ce langage purement dénotatif qu’il comparait à une pièce de monnaie: Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu’à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une pièce de monnaie, l’emploi élémentaire du discours dessert l’universel reportage dont, la littérature exceptée, participe tout entre les genres d’écrits contemporains. (Mallarmé 368)
C’est bien ce langage qui a cours dans le monde des technocrates, comme en témoigne l’exemple de Le Rantec: Il réunissait à l’intention des cadres de nombreuses conférences où les mots: cash-flow, staff and line, international management, capitaux, bilan, taxes, trésorerie, actions, holding, Europe, Amérique, Japon, pays de l’Est, Chine, export, import, optimisation, etc., abondaient et rutilaient. (80)
Ces mots qui “rutilent” brillent du même éclat que l’or du financier, c’est “l’état brut” de la parole (Mallarmé 368). Cependant, comme nous l’allons voir, la situation est plus grave encore que celle que décrivait Mallarmé, car elle correspond à un moment différent de l’homologie qui unit les systèmes linguistiques et monétaires. Remarquons simplement ici la faillite du langage poétique, qui ne subsiste plus qu’à l’état parodique, un langage grotesquement envahi par les marchandises, comme dans la chanson à la gloire de la société multinationale qu’improvise le narrateur:
Ah, Ah, importons, exportons, fabriquons, emballons, vendons et croissons, . . .
vive le porc et la viande de bœuf
importons les beaux morceaux
le rond de gîte et le rumsteck
la bavette et le filet
l’entrecôte et l’onglet
et l’aiguillette baronne
Seigneur . . .
et vive Rossery & Mitchell la belle
belle gorge et cul lardeux. (171)
Il s’agit donc bien d’un “délabrement du langage” (52), mais sa relation à la situation monétaire mérite d’être examinée de plus près, pour expliquer son exceptionnelle fragilité.
Le facteur essentiel réside sans doute dans le flottement généralisé qui frappe tous les signes monétaires dans ce système de “capitalisme organisationnel.” Ce flottement est celui de toutes les valeurs. Dans ce système de marché mondial, peu importe la valeur intrinsèque de chaque marchandise, ou même sa valeur d’usage. Seule compte la valeur d’échange, c’est à dire la relation que cette marchandise entretient avec toutes les autres marchandises sur le marché, dans un rapport différentiel purement horizontal qui n’a plus aucun point d’origine ni d’ancrage. C’est cette vérité que met à nue de façon burlesque la première “imprécation,” en expliquant les modalités de la loi de l’offre et de la demande:
Il faut donc que s’établisse le juste prix, celui qui résulte du face à face entre ce qui est offert et ce qui est demandé. . . . Si des prunes, des nèfles ou des boutons de myosotis coûtent 2,50 F le kg, ceux qui les produisent en vendront 200 kg; si en revanche, ces biens matériels coûtent 0,60 F le kg, les marchands en vendront 2000 kg. Finalement, on vendra à un prix de 1,20 F le kg, prix intermédiaire, quantité moyenne issue de cette fameuse loi de l’offre et de la demande. (14–15)
Ce flottement des valeurs s’étend d’ailleurs à l’ensemble du système monétaire et correspond à une radicalisation de la situation observée chez Gide. Il s’agit d’un détressage radical des trois fonctions de l’équivalent général qu’est la monnaie. On peut en effet distinguer trois fonctions de la monnaie, 1) celle de mesure ou étalon des valeurs, cette fonction correspond au registre idéal de l’archétype, 2) celle de moyen d’échange, il s’agit alors d’une fonction symbolique indifférente au support, c’est la monnaie jeton, enfin 3) la fonction de moyen de paiement ou de thésaurisation, qui correspond au registre du réel, au trésor (Goux, Les Monnayeurs 50). Ces trois fonctions ne se trouvent historiquement réunies que dans la circulation de la monnaie or. Dans le domaines des signes linguistiques ces trois fonctions correspondent à peu près à la distinction saussurienne entre signifiant, signifié et référent. Les Faux-monnayeurs de Gide était symptomatique de la rupture associée à la circulation de la monnaie jeton, une monnaie non convertible, divorcée à la fois de sa fonction liée au réel et de sa fonction idéale de mesure des valeurs. Dans ce cas, la loi, par pure convention despotique devient le seul garant du vide de toute garantie. La servilité absolue à la loi sans trésor s’accompagne du jeu indéfini des signes. La loi abstraite devient la garantie inébranlable de l’absurdité des signifiants. En une autre position, qui rejoint pourtant la première, c’est la récusation de tout signifié transcendantal, l’affirmation du flottement, de la dérive indéfinie des signes. (Goux, Les Monnayeurs 183–84)
La fonction symbolique d’échange se trouve alors privilégiée de façon quasi exclusive par rapport aux registre de l’archétype et du réel. Cette rupture se retrouve aussi dans la linguistique saussurienne, puis de façon plus radicale chez Derrida, dans l’affirmation d’un divorce irréparable entre signifiant, signifié et référent qui aboutit à une dérive infinie sans signifié transcendental, sans point d’ancrage de la signification. Chez Pilhes, cette situation se trouve à son apogée, car non seulement elle ne fait plus référence à la monnaie or, mais elle semble de plus atteindre le dépassement du papier monnaie lui-même. Les formes de la richesse sont quasiment impalpables et se résument en simples jeux d’écriture. Comme le souligne la seconde “imprécation,” c’est le règne des actions et des obligations sans valeur fixe, qui ne peuvent que fluctuer au sein d’une économie mondialisée. C’est aussi l’ère du “Cash-flow,” à en croire le troisième rouleau, une forme de richesse secrète, impalpable, réduite à un simple chiffre, que seuls quelques rares initiés connaissent, une somme en perpétuel mouvement puisqu’elle sert à l’autofinancement et aux investissements de l’entreprise. Ce “cash-flow” est une notion qui dépasse les frontières, et les monnaies particulières à chaque pays.
Reste-t-il un signifié transcendantal dans ce brassage fluctuant? Y a-t-il seulement une monnaie unique qui pourrait servir de point d’ancrage dans cette dérive des valeurs? La référence monétaire la plus courante, le dollar, est elle-même prisonnière du serpent monétaire et n’a pas de valeur fixe. Les mouvements des monnaies sont eux-mêmes artificiels et ne reflètent plus aucune réalité économique. Tout est possible à tout moment: “décider brusquement de laisser flotter le florin” ou “provoquer l’effondrement du franc” (213). C’est le monde du change généralisé dont Sartre décrivait déjà les implications en 1940:
Il n’y a pas de point de vue privilégié pour voir le monde. Cela veut dire, vous pouvez considérer la livre sterling comme un pouvoir d’achat abstrait, décomposable à votre gré en marks, en francs, en öres, en pengös, etc. (Sartre 179)
S’il n’y a plus de point de vue privilégié, il n’y a plus d’opinion privilégiée non plus. Il n’y a plus de valeur étalon transcendantale contre laquelle mesurer sa conduite et la faillite de la fonction archétypale, idéale, de la monnaie entraîne directement l’effondrement des idéaux:
Notre époque rendait aléatoire tout jugement sur l’engagement politique d’un citoyen cadre. . . . Alors, on exhibait sans trop s’en soucier des appartenances politiques aussi fluctuantes que les monnaies d’Europe. (144–45; je souligne)
De même que le cours de la monnaie, les convictions sont pure affaire de convention; les opinions émises, comme les billets ou les actions, ne sont couvertes par aucun trésor, aucune garantie.
C’est ainsi que pour un grand manager, il n’existe aucune différence entre les religions, les régimes politiques, les syndicats, etc. . . . le management exige le neutralisme le plus absolu, un non-engagement radical. (28)
Toute opinion est susceptible d’être échangée contre une autre, comme on échange une monnaie contre une autre. L’imprécateur a compris ce mécanisme, qui écrit
Ils savent . . . que ce que l’on appelle le patriotisme ou la dignité d’un peuple ne signifie rien du tout. . . . Ils savent que les idéologies ne pèsent d’aucun poids . . . et qu’en définitive chacun se réconcilie avec chacun devant un bon sac d’or. (223)
Ce relativisme généralisé a pour corollaire l’effondrement des autres équivalents généraux et des autres valeurs de référence, temporelles et intemporelles dans la société technocratique de L’Imprécateur. La fonction paternelle est sans aucun doute atteinte, au point qu’elle ne figure guère qu’à l’état de trace dans le texte. Le seul père présent dans le roman est Saint-Ramé, dont la fille, Betty, se drogue et semble échapper totalement à son contrôle. De façon burlesque, le texte semble même suggérer, que c’est l’entreprise elle-même qui en vient à présider à l’échange des femmes. En effet, le cadre défunt Arangrude avait rencontré sa femme lors d’une campagne publicitaire grotesque organisée par la société de charcuterie sous cellophane Korvex! Et, déclare Madame Arangrude: “C’est ainsi que je devins sa femme” (31).
L’autorité de l’état semble aussi menacée par le systèmes des sociétés multinationales. Ernest Mandel analyse d’ailleurs dans son ouvrage les tensions qui résultent de la confrontation des intérêts nationaux et de ceux du capitalisme international. Selon lui, ces tensions font que cette dernière phase du capitalisme est particulièrement sujette aux crises (326–42). C’est sans aucun doute ce qui est suggéré dans L’Imprécateur. La multinationale est plus importante qu’aucun pays individuel, même les Etats-Unis:
avant même le dollar, c’est Rossery & Mitchell-International qu’il faut défendre; à quoi servirait un dollar fort, une société occidentale unie et protégée par les Etats-Unis . . . sans la présence de Rossery & Mitchell dans le monde entier? (214)
Cette situation est très dangereuse car elle entraîne une démission du pouvoir légal qui menace la démocratie:
Le premier idiot venu en écrivant des imprécations compromet l’équilibre des forces de production. . . . Le pouvoir politique ayant presque partout abdiqué, sa place est occupée par des mouvements révolutionnaires exacerbés, des jeunesses dégoûtées, contre lesquelles il ne sera pas toujours aisé ou loisible de faire donner la police . . . il n’en faudra plus beaucoup aux populations endormies et consentantes ainsi qu’on l’est après un repas de communion pour se livrer nues aux dictatures. Croyez-moi la surconsommation effrénée, l’inflation généralisée et traitée en complice coquine et pas farouche par les ministres des finances, finiront par détruire les démocraties occidentales. (138)
De plus, comme “la confiance en la monnaie et la croyance en Dieu ont partie liée” (Goux, Les Monnayeurs 188), l’on assiste également dans L’Imprécateur à un effondrement des valeurs religieuses qui ne sont plus à même de fournir un étalon aux actions humaines. Le monde transformé en une vaste entreprise est nécessairement athée. Selon les technocrates, la séparation de la justice et de l’économie a remplacé celle de l’Eglise et de l’Etat, l’un faisant du “social,” l’autre beaucoup d’argent. En quelque sorte, le pouvoir temporel appartiendrait aux entreprises et aux banques, et le pouvoir intemporel aux gouvernements. Les temples, les églises et les synagogues le céderaient aux grands ministères. (8)
Mais bientôt, comme le veut la fable racontée par L’Imprécateur, la loi, comme la fonction paternelle, est impuissante à enrayer le mouvement de dérive institué par l’appareil financier. La loi de l’état, ainsi que la loi de l’église disparaissent en tant qu’équivalents généraux et mesures des valeurs, tandis qu’une troisième loi et une parodie de justice apparaissent, ainsi que le prédit Ronson:
Je vous parle pour la première fois de la Justice d’Entreprise, car sans doute vous a-t-on appris bêtement qu’il n’existait que deux justices acceptables et souveraines, celle de Dieu et celle des hommes, des Etats et de leurs tribunaux civils et militaires! . . . Bientôt . . . attendez-vous à la Troisième justice, celle de l’entreprise mondiale . . . le jour où le monde ne sera plus qu’une seule et immense entreprise, alors ce jour là ne régnera plus sur cette terre qu’une seule et unique justice: la nôtre. (232)
L’internationalisation de la loi suit celle du capital dans l’éclatement des frontières qui mène au fascisme.
Ce flottement général atteint tout le système de signification, et en particulier la circulation des signes linguistiques. Les mots aussi deviennent de véritables billets à ordre sans encaisse. Dans les échanges entre les technocrates, les concepts sont séparés du trésor du savoir qu’ils sont supposés représenter, et ne sont plus que des signifiants vides, des instruments de crédit pour spéculer et se faire valoir. Devant les péroraisons creuses de Le Rantec, chacun se tait “tant il était admis en ce temps là que le fait de prononcer certains mots à un micro était signe de puissance et dispensait du savoir” (80). Dans cet univers de dérive des valeurs, dans ce monde du change monétaire, la seule chose qui importe est de savoir donner le change. C’est ainsi qu’interrogé sur la possible culpabilité d’un de ses collègues, le narrateur ne songe en rien à soigner le contenu de sa réponse. Seule importe la forme et le crédit qu’elle offre: je savais qu’une réponse claire et rapide, prononcée d’une voix forte et au timbre neutre plaisait à ces chefs d’outre-Atlantique, car elle impliquait selon eux une pensée claire et une connaissance approfondie du dossier en discussion. (52)
Puisqu’il n’y a pas de vérité absolue véhiculée par le langage, il importe simplement de plaire et de conserver sa position au sein du système.
Dans ce système de dérive absolue des signifiants, le talent le plus utile est celui de l’interprète, de l’exégète. Toutes les paroles sont en effet en porte à faux par rapport aux intentions. Le décalage est irrémédiable, les mots ne coïncident jamais avec la pensée, le trésor que chacun porte enfermé en soi. Aucune déclaration n’est à prendre pour argent comptant:
le rappel d’une politique de libre expression à l’intérieur de la société traduisait plus un usage discursif, un procédé verbal, qu’une réalité. Il ne serait venu à l’esprit d’aucun cadre, y compris le plus téméraire, de prendre au mot les paroles des dirigeants. (43)
Sans cesse, le narrateur insiste sur la nécessité de traduire, non seulement l’américain des dirigeants de Des Moines, mais encore et surtout le Français codifié de la direction française. Il n’existe pas de correspondance directe et immédiate, la signification doit être déduite du contexte différentiel.
Cependant cette situation est encore compliquée par le fait qu’il n’existe pas de point de vue privilégié pour juger, pas de code stable, et de ce fait le statut du faux, du vrai, ou de l’authentique est extrêmement problématique. Selon le narrateur, tout dépend du point de vue adopté: “le langage que je leur tins au cours de cette réunion n’était faux qu’en apparence du moment que personne ne lui ajoutait foi” (43). Tout bientôt est susceptible d’être mis en doute. Toutes les déclarations verbales émanant de la direction sont soumises à “une recherche immédiate d’authenticité” (129), puisque l’imprécateur, imitant le directeur général fait circuler des fausses nouvelles, émet de la fausse monnaie. Cependant, même les paroles directement assumées par Saint-Ramé ne doivent pas être prises pour argent comptant, et il s’avère qu’en fin de compte il est lui-même l’auteur de ces fausses nouvelles, que lui seul était capable de s’imiter si parfaitement, de faire circuler des faux si parfaits. Où qu’on creuse, sous le faux, on trouve encore du faux, l’effondrement des valeurs donne naissance à un faux-monnayage généralisé.
Il résulte de cette situation une crise absolue de la signification. Le problème central posé par les “imprécations” n’est autre en effet que celui de leur signification. Dès la première, le narrateur reconnaît qu’il lui appartient d’“interpréter” leur texte, ce qui s’avère problématique. Les avis sont partagés sur sa signification, certains en rient comme d’un canular, les autres y voient “un texte plus incomplet que faux,” d’autres sont d’avis qu’il tourne la direction en ridicule, tandis qu’une secrétaire pense qu’il va surtout irriter les syndicats. Le problème central est qu’il ne s’inscrit pas dans le système connu de signification qui a cours dans l’entreprise. Il résiste à l’exégèse habituelle car “il ne ressemble à aucun texte connu. Ce n’est pas un tract syndical, ce n’est pas un texte de propagande politique, c’est un texte simpliste sans motivation” (43). C’est un texte “à mi-chemin entre le canular et l’admonestation déguisée” (35); c’est bien un problème de genre qui se pose ici. Cette crise généralisée de la signification débouche alors sur un délire d’interprétation paranoïaque qui finit par envahir toute la narration. Sans cesse dans le texte s’échaffaudent des interprétations hypothétiques qui tournent à l’obsession. C’est l’ère du soupçon radical. Le moindre mot est déchiffré comme un hiéroglyphe: “pensez-vous que ce texte ait été rédigé par un de vos collaborateurs?” demande Musterffies. Aussitôt, l’expression “vos collaborateurs” déclenche le délire d’interprétation des signes:
Etait-ce une provocation? Me rendait-on responsable des troubles? Son intention était-elle de dissocier Saint-Ramé, patron de la firme du directeur adjoint des Relations humaines . . . ? Et alors était-ce là le fin mot de ma présence à ce dîner? (51–52)
Il apparaît ainsi combien situation économique et phénomènes linguistiques sont liés, et combien l’équation posée par le narrateur et citée en introduction est exacte. On comprend aussi comment une complète déstabilisation du système peut venir du langage lui-même. Dans ce monde de dérive de la signification, il suffit de donner un petit coup de pouce pour que tout bascule, et pour que le langage apparaisse comme maléfique. Le langage de l’imprécateur représente le contraire de celui de l’entreprise. En effet, si l’on se rapporte à la définition du mot “imprécation” donnée dans le texte, un détail retient notre attention: il s’agit en premier lieu d’une “Figure de rhétorique” (69). Le langage de l’imprécateur est une vengeance de la rhétorique, une rhétorique devenue folle qui peu à peu gagne par contagion l’ensemble de la narration. C’est aussi un langage qui échappe au système de décalage en vigueur, et qui dit tout haut ce que chacun cherche à camoufler sous des paroles choisies. Le digne Roustev lui-même semble être atteint par cette crise du style. Il n’est pas jusqu’au brave agent de police en faction devant l’immeuble qui se met à employer ce “vocabulaire et [ce] style proprement inouïs”: “Je crois qu’on craint l’effondrement de l’immeuble de verre et d’acier qui se dresse là-bas au coin de l’avenue de la République et de la rue Oberkampf” (234). Ce langage est aussi, de plus en plus, celui du narrateur et donc de l’ensemble de la narration. Ainsi, c’est le livre entier qui est une longue “imprécation,” souhaitant le malheur et annonçant la perte de la société de consommation “postindustrielle.” Malgré les apparences, l’imprécateur est avant tout le narrateur. Le texte représente donc la tension entre deux langages irréconciliables, entre deux visions du monde contradictoires, et il semble bien que le narrateur dans ce cas ait raison lorsqu’il souligne les éléments tragiques inhérents à toute cette affaire.
Toute cette situation rejaillit bien entendu sur l’esthétique narrative du roman. Les mêmes effets de flottement s’y retrouvent. Cependant, malgré la correspondance que nous avons soulignée entre le quatrième moment de la périodisation de Goldmann, et le livre de Pilhes, force nous est de reconnaître que L’Imprécateur n’appartient pas à la catégorie du Nouveau Roman. De même, il faut remarquer que ce roman marque une rupture par rapport aux expériences littéraires de Valéry Larbaud, de Gide, de Cendrars ou d’Apollinaire que Jean-Joseph Goux liait à cette situation économique (“Banking on Signs” 18). Nous ne retrouvons pas l’aspect fragmenté, hétérogène, et disjoint qui caractérisait ces œuvres. Au contraire, ce roman correspondrait assez bien à un nouveau moment littéraire, celui d’un post-modernisme qui, abandonnant les expériences radicales du Nouveau Roman reviendrait à un certain réalisme dans la narration, sans toutefois adopter la sereine autorité qui l’accompagnait à l’époque de son apogée au dix-neuvième siècle. Cette nouvelle rupture serait à situer aux environs des années soixante-dix après l’essoufflement du mouvement avant-gardiste Tel Quel qui disparaît avec les événements de mai 68. C’est ainsi que l’on peut considérer ce post-modernisme comme une extension plus froide du modernisme, qui tout en conservant les mêmes interrogations, revient à une facture plus classique, traitée avec un certain détachement ironique. Cette littérature ne serait plus fondée sur le terrorisme et l’élitisme avant-gardiste, mais plutôt sur le plaisir d’un plus large public.
C’est, je crois, cette forme curieuse de réalisme déstabilisé et en porte à faux qui caractérise l’esthétique de L’Imprécateur. Nous sommes en effet, à première vue, revenus à un point de vue unifié dans la narration: il s’agit d’un récit autodiégétique apparemment classique et dont le point de vue reste cohérent d’un bout à l’autre de l’œuvre. Cependant, le point de vue du narrateur ne constitue en aucune façon un point de vue privilégié pour voir le monde. Nous sommes loin ici des narrateurs omniscients de Balzac ou Zola qui exposaient sereinement une histoire cohérente à tous les niveaux. Dès les premières pages, le narrateur nous avertit: “Ce n’est pas que je fus témoin de tout. Je n’ai pas tout vu, je n’ai pas tout entendu. J’ai dû reconstituer des pans entiers de l’affaire et d’innombrables lambeaux,” et si “la version des experts est fausse” (6), celle qui nous est présentée est loin de jouir d’une autorité absolue. En effet, les incursions périodiques de passages situés apparemment dans un hôpital où le narrateur semble être soigné, ainsi que l’incrédulité des médecins au sujet des faits qu’il relate, mettent en question le statut de l’ensemble du récit. De plus, la fin du roman semble faire basculer tout ce qui précède dans l’irréel en affirmant que le narrateur vient en réalité de passer plus d’une semaine dans le coma et que rien de ce qu’il a raconté, ou rêvé, n’est advenu (284). Cependant, même cette certitude nous est immédiatement enlevée par la fin apparemment circulaire de la dernière page: “Eh bien, il paraît qu’Arangrude s’est tué hier soir en rentrant chez lui, sur le boulevard périphérique. . . . Le saviez-vous?” (286). Le même flottement qui affectait toutes valeurs touche donc également la narration. Ici encore, le statut du vrai, du faux, de la réalité et de la fiction est plus que problématique. Les problèmes d’herméneutique que confrontaient les personnages se posent également pour le lecteur. Ainsi, dès la première page, les mots ne semblent pas correspondre à leur signification apparente. Lorsque le narrateur annonce qu’il va “raconter l’histoire de l’effondrement et de la destruction” de la filiale française de la compagnie multinationale Rossery & Mitchell” (5), la première réaction est de penser qu’il va s’agir d’un effondrement économique, d’une destruction financière, mais cette vue est bientôt démentie par l’allusion, à la page suivante, à “l’hypothèse d’un affaissement du sol” (6). C’est bien d’un effondrement physique, littéral autant que métaphorique qu’il va être question.
Le récit est encore déstabilisé par d’autres éléments. Ainsi par exemple, l’un des aspects le plus troublants dans ce roman est la prolifération de discours purement hypothétiques. A de multiples reprises, le narrateur se plaît à exposer ce que quelqu’un aurait pu dire, ce que personne n’a dit ou ce qu’il aurait dû dire. Souvent, ce qui a réellement été dit suit ce discours hypothétique, mais l’effet reste d’un certain flottement de la signification. Parfois, par exemple, l’oraison funèbre imaginaire sur la tombe d’Arangrude, de tels passages s’étendent sur plusieurs pages, au point que l’on perd pied entre ce qui est donné comme réel et ce qui n’est qu’hypothétique. Un flottement similaire touche la dimension temporelle de tout le récit. En effet, plusieurs événements historiques mentionnés dans le récit (le putsh chilien, mai 68, le choc pétrolier, le dollar de 1973, etc.) semblent indiquer que le roman relate des faits à peu près contemporains de sa parution. Cependant, le narrateur utilise de façon constante un ton épique qui vise à situer l’action dans un passé assez lointain: “en ce temps là . . .,” et son récit implique à plusieurs reprises que la société qu’il décrit a été détruite depuis ces événements. L’incertitude mine donc en profondeur le discours réaliste de surface.
En outre, le récit mêle à plaisir des tons apparemment incompatibles, allant du burlesque à l’épique et au pathétique, en passant par le tragique. Au moment d’insérer le curriculum vitae d’un personnage, composante éminemment classique du roman réaliste, le côté arbitraire de cette description est souligné: “Ce bref entretien téléphonique me fournit l’occasion de dresser un portrait de M. Roustev,” tandis que le vocabulaire utilisé nous transporte du côté des contes de fées: “Il y eut une fois un entrepreneur français qui fabriquait des machines . . .” (48). De même que pour les “imprécations,” le problème de genre se pose pour L’Imprécateur. C’est à la fois un roman policier, un “suspense,” un récit fantastique de politique fiction, et un conte philosophique. Enfin, comme nous l’avons souligné précédemment, les registres de langage se mèlent et s’opposent avec, de façon grandissante, une contagion de la rhétorique folle des imprécations semée de curieux syntagmes figés tels que l’adresse du fameux “immeuble de verre et d’acier.” Le “réalisme” du récit est lui aussi atteint par la crise de signification qui touche l’ensemble de l’univers du roman.
LIRE SUITE FIN
- NOUVEAU RÉALISME, NOUVELLE MONNAIE: L’ÉCONOMIE DES SIGNES DANS "L’IMPRÉCATEUR" DE RENÉ-VICTOR PILHES - par Nathalie Buchet Rogers Wellesley College -
- "L’IMPRÉCATEUR" DE RENÉ-VICTOR PILHES - par Nathalie Buchet Rogers Wellesley (SUITE et fin) -

