« L’oncle Sam et le Mandarin » par le Général Henri PARIS – Note de présentation & lecture de Jean-Luc Pujo - Mars 2014
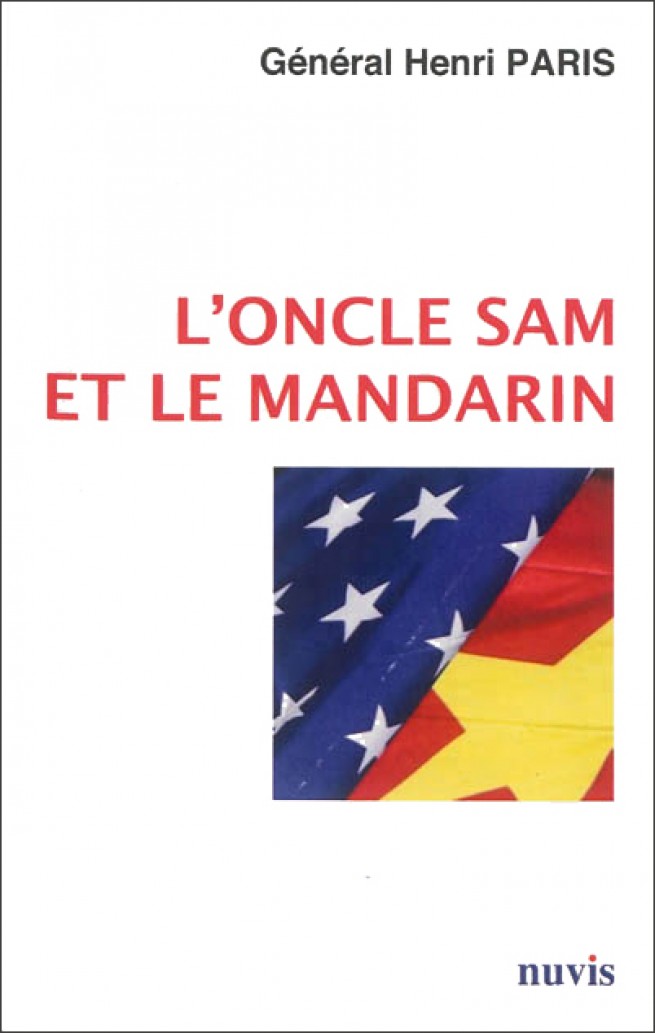
- Café hyper-républicain du 29 mars 2014 à Paris Bastille -
Mon général, « Merci » d’avoir répondu à notre invitation pour discuter avec nous sur l’ensemble des nombreuses questions soulevées par votre livre passionnant.
Je rappelle que vous êtes Saint-Cyrien, vous avez exercé plusieurs commandements prestigieux notamment celui de la 2e division blindée (2ème DB), après avoir servi dans les troupes aéroportées et la Légion étrangère et, à ce titre, participé à la campagne d'Algérie.
Vous avez été « conseiller » du Premier ministre Pierre Mauroy et de deux ministres de la défense, Jean-Pierre Chevènement et Pierre Joxe, puis vous avez dirigé la Délégation aux Etudes générales.
Enfin, vous avez été « conseiller » militaire de « GIAT industries ».
Vous êtes également un auteur prolixe. Pour ne citer que quelques titres, vous avez publiés :
- « Stratégie militaire soviétique et américaine » (Prix Vauban 1981).
- « Les fondements doctrinaux de la stratégie soviétique, en collaboration avec les membres du Groupe d'études et de recherche sur la stratégie soviétique » - FEDN, Sept Couleurs.
- « Le pacte de Varsovie en action ». Votre thèse de Doctorat.
- « Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie » - Publications de la Sorbonne - 1995.
- « L'atome rouge » - l'Harmattan - 1996.
- « L'arbalète, la pierre à fusil et l'atome » - Albin Michel - 1997.
- « Vers une armée citoyenne » - Direction d'un ouvrage collectif - L'Harmattan - 1998.
- « Cent complots pour les Cent-jours » - L'Harmattan - 2001
- « USA : échec et mat » - Edition Jacques-Marie Laffont – 2004
- « Le pétrole tue l’Afrique » – Edition Des Riaux - 2007
Enfin, vous dirigez une association politique « DEMOCRATIES » qui organise des débats politiques passionnants sur des thèmes très divers:
- la Syrie ;
- Le concept de la guerre aujourd’hui ;
- La tragédie du Rwanda, ce 1er avril 2014 ;
- La Francophonie.
- ETC.
***
Mon général, « Encore Merci » d’avoir bien voulu accepté notre invitation pour échanger d’autour de votre dernier livre.
Vous venez – en effet - de publier en novembre 2013 un essai « L’oncle Sam et le Mandarin » traitant des enjeux stratégiques mondiaux face au choc de deux puissances : Chine et Etats-Unis.
Je vais tenter – si vous le permettez - de restituer quelques uns des points essentiels de votre réflexion avant de vous laisser toute liberté pour présenter ce travail.
Vous écrivez :
« Entre la Chine et les Etats-Unis, le conflit est inexpiable.
Les intérêts sont par trop divergents, ne serait-ce que l’exploitation des ressources pétrolières mondiales, ce qui n’est que l’une de leurs moindres rivalités.
L’une des deux superpuissances est de trop sur la terre ou devrait radicalement changer de politique et de stratégie comme l’a fait l’URSS en son temps, à la fin de la décennie 1980, mais pour périr. Les annales n’en ont pas été oubliées à Pékin.
Un tel changement est peu vraisemblable tant de la part des Etats-Unis que de la Chine.
Aussi, les deux superpuissances sont-elles condamnées au duel, d’abord à fleurets mouchetés, puis démouchetés ». p.399
(…)
« Les rapports de puissances sont compliqués et tranchés, sans que la bascule apparaisse pencher franchement en faveur d’un des deux adversaires.
A bien examiner les faits, le conflit armé a déjà débuté entre les deux superpuissances. »
(…)
Vous poursuivez :
« En cette première partie du XXIème siècle, une guerre sino-américaine, généralisée et intercontinentale, avec échange nucléaire stratégique est peu plausible, ne serait-ce que parce qu’aucun intérêt vital n’est en jeu. Et chacun des adversaires se garde bien de mettre l’ennemi au pied du mur, en ne lui laissant que la guerre comme terme de l’alternative.
(…)
Le plateau de la balance nucléaire penche plutôt du coté américain, mais cette fenêtre d’opportunité en faveur de Washington est à peine entrebâillée. Elle est appelée à se refermer avec la fin de la décennie, au plus tard lors de la décennie suivante, les années 2030 présidant à la montée en puissance des Chinois comme des Américains. Cette agression, si agression il y a, proviendrait du côté américain dans les années 2010 ou 2020. »
Et vous concluez :
« L’hypothèse d’une guerre nucléaire intercontinentale sino-américaine est invraisemblable, à moins que les deux camps se lancent dans un aventurisme digne d’un joueur de poker.
Ce n’est pas pour autant que la situation conflictuelle soit amenée à s’apaiser, bien au contraire. »
Mais alors quels types de guerres nous menacent actuellement ?
Vous écrivez : « L’hypothèse d’une guerre locale et limitée en matière d’armement comme de délimitation géographique, et de protagonistes est tout à fait possible. Elle pourrait opposer Chinois et Américain directement ou par alliés interposés avec ou sans l’appui de « volontaires » chinois et américains. Ce ne serait que la réédition de la guerre de Corée. »
Quand aux champs de bataille, vous précisez :
« Le champ de bataille le plus évident - et bien circonscrit géographiquement - est l’Afrique subsaharienne et ses zones pétrolifères. Les Chinois sont déjà bien implantés au Soudan, visant le Darfour et le maintien du contrôle de l’oléoduc menant à la mer Rouge. Leur implication dans la Corne de l’Afrique est appelée à s’amplifier. »
Vous poursuivez : « Le soutien à tous les mouvements anti-américains dans la région du Golfe de Guinée n’est est qu’à ses débuts en 2012.
(…) c’est donc une lutte à fleurets démouchetés que livrent les Chinois contre les américains au premier chef, puis les Britanniques et les Français ».
Vous poursuivez : « L’Afrique subsaharienne représente un terrain d’excellence pour de tels objectifs.
La région du détroit de Malacca représente un autre théâtre d’opération, certainement non exclusif de l’Afrique ».
Et enfin, pour nous rassurer concernant les tirs nucléaires, vous rajouter :
« L’attaquant agissant même à l’abri d’un bouclier antimissile éprouvé, n’a aucune garantie qu’il soit suffisamment efficace pour ne pas s’attirer une riposte dévastatrice. Rationnellement, le risque ne peut être accepté ».
OUF ! Mais vous rajoutez :
« L’impondérable est évidemment un manquement à la rationalité et la chute dans l’aventurisme. C’est très peu probable, mais pas impossible » !!!
***
En quelques mots, nous comprenons ici quel est le tableau magistral que vous dressez tout au long de ces 400 pages passionnantes où vous passez en revue les institutions politiques, administratives, militaire de chacune de ces puissances pour dresser un panorama géostratégique mondial époustouflant dans une période très particulière :
« Nous vivons actuellement – en 2012 – 2013 – une rupture stratégique » p.386 écrivez-vous.
Laquelle ? Et quels en sont les termes ?
Nous allons – si vous le voulez bien – tenter de redessiner le tableau général des enjeux stratégiques tels que vous l’exposez.
***
La première partie de votre ouvrage est consacrée aux Etats-Unis.
Je le disais, vous nous livrez d’abord un exposé académique concernant l’ensemble des institutions américaines, pour conclure sur la toute puissance du Dollar, la maitrise du système Dollar dont la crise « est appelée à perdurer sur un mode chronique, rampant, avec des poussées de fièvre périodiques » p.46 – dites vous.
« Le seul soutien du dollar est dans la sauvegarde, voire dans les capacités d’influence des Etats-Unis dans le monde. Ces capacités d’influence relèvent d’une combinaison de divers facteurs. En font partie la diplomatie, le renseignement, le prestige… et aussi la suprématie de leur force armée accolée à son emploi et à sa menace d’emploi. (…) Par bien des aspects, le dollar doit son pouvoir à la puissance militaire des Etats-Unis d’Amérique ». Concluez-vous. p.47
Comment et où s’exerce plus particulièrement cette domination ?
Vous analysez dans le chapitre II « la politique américaine dans la région ASIE-PACIFIQUE » p.49
Cette analyse débute sur la présentation du système OTAN (modèle de soft power), sa prolongation tentée vers le Moyen-Orient (le fameux projet de Grand Moyen-Orient et son échec) puis la tentative d’imposer des Traités dans la région ASIE-PACIFIQUE.
Vous dressez alors l’historique des projets et contre-projets :
- le défunt traité OTASE conclu le 8 septembre 1954 et abrogé le 30 juin 1977 (après la chute de Saïgon – avril 1975) ;
- le projet commercial de TransPacific Partnership (TPP) en contournement des règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ;
- le contre-projet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) signé en août 1967 dont sont exclus les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle –Zélande ;
- le sommet de l’ASIE du Sud-Est (EAS) – ASEAN élargie ;
- enfin, le Traité de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), initiative australienne lancée en janvier 1989 ;
Les Etats-Unis n’ont pas réussi à imposer en Asie, un Traité de défense mutuelle comme l’OTAN, remarquez-vous.
Et « faute de traité de défense mutuelle» - les Etats-Unis tentent de multiplier les traités de sécurité bilatéraux.
- traité de coopération et de sécurité mutuelles entre le Japon et les Etats-Unis signé en1960 ;
- traité de Manille (août 1951) ;
- traité avec la Corée du Sud ;
- etc.
Aujourd’hui, les Etats-Unis travaillent à la signature de traité sur le modèle signé avec le Japon ou la Corée du sud avec :
- L’Inde ;
- Le Pakistan ;
Malheureusement « l’antagonisme entre ces deux pays - Inde et Pakistan - retarde tout rapprochement » dites-vous.
Il est vrai que les Etats-Unis rencontrent – vous le constatez - de nombreuses difficultés.
- échec du projet de Grand Moyen Orient – irrémédiablement aboli avec la décennie 2010 (p.75) ;
- évacuation de l’IRAK ;
- évacuation de l’Afghanistan ;
- Affaire Syrienne ;
- Etc.
Vous constatez – de plus - que les relations avec les alliés traditionnels des Etats-Unis sont difficiles.
Vous dressez alors un état des lieux sans concession de l’alliance japonaise et le retournement capital de la politique de défense du Japon depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre « Shinzo ABE » au début de l’année 2013.
Vous présentez un tableau précis des impératifs de la politique intérieure nippone qui permet au lecteur de mieux comprendre le tournant historique et ses enjeux avec – notamment- la présence de bases américaines, jouissant d’un statut d’extra-territorialité, ce qui pose problème. (p.84)
Vous soulignez que « la contestation de la domination américaine s’accompagne d’un bouleversement » : « de géant économique et de nain politique et militaire, le Japon a changé de Nature » p.87 dites-vous.
Le budget de la défense du Japon est passé de 45 milliard d’Euros en 2012 à 46 milliard en 2013. C’est le 6ème budget de Défense de la planète.
A titre de comparaison, vous rappelez que celui de la France oscille entre 28 à 31 milliard. P.88
Vous concluez : « l’Alliance nippo-américaine évolue donc vers un partenariat égalitaire exempt de paternalisme » p.89
Vous constatez également que l’environnement extrême oriental du Japon est riche de tensions, notamment :
- avec la Chine (en mer australe) avec le contentieux lié à plusieurs « Iles » auxquels se rattachent des Zones d’intérêts économiques susceptibles de receler pétrole et gaz. P.91
- avec la Corée du Nord. Le Japon étant directement menacé.
Vous notez un climat de tensions et de méfiance :
« Ainsi, les alliances entre Etats-Unis et Corée du Sud, menaces chinoise et nord-coréenne auraient dû favoriser des relations cordiales entre Japon et Corée du Sud. Or, il n’en est rien : il y a bien alliance, mais empreinte de méfiance. » p.93
Vous dressez alors un tableau général – passionnant - de l’appareil militaire américain dans la Zone Asie-Pacifique – c’est votre chapitre IV.
« Un appareil militaire est la transposition rigoureuses et cohérente d’un système de politique extérieure » écrivez-vous p.103
Vous rappelez alors « la bascule stratégique américaine » opérée durant l’année 2012 vers le Pacifique.
Et vous nous livrez alors une analyse technique et stratégique à l’appui de cette affirmation. Vous analysez les budgets de Défense, les types d’armements, les composantes conventionnelles opérationnelles aérienne, aéro-navale et aéroterrestre des forces américaines, avant de conclure :
« Globalement, la puissance militaire américaine reste intacte. Elle est indiscutablement prédominante dans les relations internationales et appelée à le demeurer dans tout horizon prospectif. Cependant, cette puissance militaire est construite pour s’opposer victorieusement à un adversaire employant des moyens symétriques, c'est-à-dire des moyens blindés et mécanisés aussi bien que nucléaires. Les forces armées américaines sont incapables de vaincre un adversaire leur disputant un terrain qu’elles n’arrivent pas à contrôler à la longueur du temps. »
(…)
Vous poursuivez :
« Les forces américaines notamment les composantes terrestres et navales surtout terrestres n’ont de pire faiblesse qu’en elle-même ».
« C’est bien l’aptitude à mener une guerre de contre-insurrection qui est incriminée ».
***
Après ce tableau des enjeux attachés à la puissance américaine, vous abordez ceux attachés à la puissance chinoise.
Vous procédez alors au même exercice qui devient encore plus passionnant, car nous avons beaucoup à combler de notre méconnaissance de la réalité chinoise.
Organisation de l’Etat, monnaie chinoise et ses particularités face à la guerre monétaire mondiale, rôle du Parti – luttes internes et dérives – corruption, affairisme – et état de la société chinoise caractérisé par des troubles sociaux importants…
Le tableau de la situation interne est passionnant – vous écrivez : « La situation ressemble à celle qui prévalait en Europe occidentale au XIVeme et au XVème siècle, durant les temps morts qui séparaient la reprise de la guerre connue comme étant celle de Cent ans. Les campagnes et les villes étaient la proie de l’errance de mercenaires sans emploi, les « Grandes compagnies ». Autre analogie, la Guerre des Paysans qui ravagèrent l’espace allemand au XVIème siècle. A quand les Jacques chinois, à la recherche d’un seigneur de la guerre ? » Interrogez-vous p. 178
Le tout étant menacé par des poussées de nationalisme et de séparatisme (Tibet, Mongolie intérieure, Xinjiang)…
Vous abordez alors – à ce stade – la politique extérieure chinoise et notamment sa diplomatie pétrolière (Proche et Moyen-Orient, Afrique, Amérique Latine) en rappelant les enjeux cruciaux rattachés à l’énergie.
Vous écrivez : « Les Etats-Unis et la Chine mobilisent respectivement 25% de cette énergie soit donc à eux deux la moitié de la consommation mondiale. »
« La politique pétrolière chinoise n’est guère spécifique. Il est possible d’évoquer une diplomatie pétrolière chinoise au même titre qu’une diplomatie pétrolière américaine. Les chinois cherchent à préserver leurs gisements nationaux en vue des réserves stratégiques, très exactement à l’instar des américains. (…)
Deuxième aspect de la politique d’importation, toujours la même pour les Etats-Unis et la Chine : la diversification des sources d’approvisionnement. » p.198
Vous abordez alors les enjeux stratégiques rattachés :
- aux voies maritimes d’approvisionnement et le fameux détroit de Malacca ;
- à la présence chinoise en Afrique ;
- à l’alliance russe et au rôle de l’Asie centrale ( Kazakhastan ; Turkménistan) ;
- au rôle primordial de plusieurs traités – Nous y reviendrons :
o l’OCS ( Orga. de coopération de Shangaï) ;
o Le TAC (Traité sino-russe d’amitié) ;
o Le traité de sécurité collective (OTSC) avec la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Arménie et la Biélorussie) ;
o La place particulière de l’Ouzbékistan (et le hub américain avec aval russe)
Enfin, vous offrez également à vos lecteurs une analyse des relations avec l’Inde, l’Amérique latine.
Vous vous attardez sur la question complexe de Taïwan.
Vous abordez aussi les enjeux liés aux « terres rares ». p.213
Et vous vous interrogez sur les tensions entre la Chine et l’Union européenne. P.214
*
Si les Etats-Unis entretiennent des relations complexes avec le Japon ou la Corée du Sud, il est en de même pour la Chine avec ses alliés : l’Iran et la Corée du Nord.
Vous présentez alors en plusieurs tableaux passionnant la situation de la Corée du nord – institutions, histoire et relations diplomatiques.
Vous dressez un état des lieux de la situation militaire des forces en présence ; vous évaluez – en militaire - les différents potentiels à la fois conventionnel et nucléaire ;
Puis vous décrivez avec la même précision la situation iranienne.
Ces pages sur la Corée du Nord et sur l’Iran sont passionnantes et rares de par leurs précisions.
Tout naturellement, vous amenez vos lecteurs vers un des chapitres les plus importants : « les forces armées chinoises – Commandement, stratégie et menaces principales ».
Là encore, c’est le militaire qui devient écrivain. Les pages sont techniques, précises à l’appui d’une analyse géostratégique impressionnante.
« Les chinois renforcent leur défense, tandis que les Occidentaux abaissent le niveau de la leur » écrivez-vous p. 275
Et vous poussez plus avant l’analyse du potentiel chinois en abordant plusieurs chapitres étonnants consacrés à « la composante nucléaire et à la cyberguerre ». p.278
« Ce sont les enjeux des années à venir : cybernétique, cyberespace et cyberguerre. » écrivez-vous p.288
« Dans cette guerre, les chinois entrent de plain-pied avec les Occidentaux donc sans subir de retard. » remarquez-vous.
Or, dites-vous :
« La cybernétique est une discipline neuve, dans laquelle les Chinois se sont rués. Particulièrement la cybernétique, avec son abstraction correspondante qu’est le cyberespace, cadre parfaitement avec la tournure intellectuelle des Chinois ».
Vous précisez :
« sous le vocable de cybernétique, s’entend une science que constitue l’ensemble relatif au processus du contrôle, de la régulation, de l’observation et de la communication réalisée par l’Homme allié à la machine, dans le cadre du spectre électromagnétique » p. 289
Je crois pouvoir dire que ces pages sont passionnantes qui nous permettent de comprendre notre avenir proche, avenir technologique complexe.
« Cyberguerre, Dissuasion nucléaire, Bouclier antimissiles… »
La combinaison de toutes ces technologies vous amène à cette conclusion sidérante qui illustre le basculement stratégique actuel :
« Les chinois n’ont rien à envier aux américains et réciproquement. On en arrive au constat de la possibilité de l’inanité d’une attaque nucléaire quelle qu’en soit la modalité » p.300
Vous allez alors - dans un chapitre IX - poursuivre votre analyse des forces armées chinoises à travers l’analyse des programmes militaires actuels notamment en matière navales et spatiales. P.303
Le tout étant illustré par de nombreuses précisions et de nombreux faits que vous étudiez par le menu, ce qui devient passionnant notamment concernant le rôle du Complexe militaro-industriel chinois.
***
Après l’examen des potentiels américains et chinois, de leurs forces et de leurs faiblesses, de leurs alliances et du potentiel de leurs partenaires, vous consacrez deux chapitres entiers à deux dossiers techniques importants :
- le Bouclier antimissile ;
- la Défense antimissile de théâtre élargie ;
Dans le chapitre consacré au bouclier antimissile, vous présentez là aussi un tableau complet des enjeux stratégiques, des avancées technologiques et des recherches en cours.
Vous vous attardez sur un point qui interroge le lecteur et sur lequel je veux m’arrêter une minute.
Vous notez que – je vous cite - « les Etats-Unis ont été amené à dénoncer le traité ABM parce qu’un amendement datant de 1997 au régime MTCR interdisait la mise au point, le déploiement et la cession d’un missile antimissile atteignant une vitesse supérieure à 3000m/s. (…) ».
Or, expliquez-vous, cette vitesse - à laquelle étaient parvenus les américains, et qui contrevenait au fond et à la forme du traité - avait pour but l’interception de missiles intercontinentaux.
Les américains avaient donc l’obligation de dénoncer le traité pour poursuivre leur recherche et leurs essais.
Soit. Soyons respectueux des traités.
Or, je voudrai revenir sur le calendrier que vous proposez.
Les dates ont leur importance et j’attire ici l’attention de vous tous.
Je note :
- les recherches américaines poussaient à reconsidérer le traité ABM de 1972 (traité AntiBallistic Missile) et les accords SALT I – (Stratégic Armament Limitation Talks) - Traité ABM signé à Moscou le 26 mai 1972 ;
- Or, les Chinois et les Russes refusaient la révision de ce traité et firent notamment adopter par l’Assemblée générale des nations unies – lors de la 54ème session en décembre 1999, une motion en faveur du maintien du traité ABM;
Si vous le voulez bien, reprenons le calendrier:
o Décembre 1999 : vote des Nations Unis contre la révision du traité ABM ;
o Juillet 2001 : signature du traité d’amitié sino-russe dont un point est consacré au maintien du traité ABM ;
o Octobre 2001, les Russes reconsidèrent leur position.
o Décembre 2001 : les américains dénoncent le traité ABM ;
Je note :
- Que c’est au cours d’une session de l’Asia Pacific Economic Coopération (APEC), en octobre 2001, que Moscou lève son opposition ;
- Que les chinois ont été tenu à l’écart de toutes discussions ;
Or, quelle étonnement – Mon général – de constater qu’entre juillet 2001 et octobre 2001, il y a les mois d’août et de septembre 2001 !
Si août ne nous intéresse que peu, en revanche septembre 2001 retient toute notre attention.
Le 11 septembre 2001, nous avons connu les attentats les plus spectaculaires de notre époque moderne.
Je note que vous n’en parlez pas – certainement pour mieux attirer notre attention.
Nous ne pouvons que vous interroger sur ce modeste « point de détail ».
***
Le chapitre consacré à la défense antimissile (DAMB) et bien sûr l’un des plus passionnants.
Et je veux terminer sur une des considérations soulevées relatives au financement de l’OTAN.
Vous écrivez : « les alliés de l‘OTAN ont perpétuellement été les voyageurs resquilleurs du train de la stratégie du monde occidental. Et lors de cette nouvelle lutte qu’est la défense antimissile, les Européen de l’OTAN se montrent toujours aussi irresponsables et atermoient au lieu de participer pleinement à la lutte ». p.378
N’avez-vous pas l’impression – Mon Général - que les européens – impuissants à s’organiser – pour le plus grand bénéfice des américains - supportent déjà l’essentiel de l’économie américaine par un soutien sans faille et douloureux au système financier et monétaire – celui du Dollar ?
Autrement dit, les Européens – par leur soutien au Dollar - financent les armadas américaines sur toutes les mers du monde.
Faut-il en faire plus ? Ne faut-il pas envisager au contraire une émancipation des nations européennes ?
***
Mon Général, nous arrivons à la conclusion.
Votre livre est exceptionnel.
Il permet au lecteur de faire le point sur l’ensemble des enjeux stratégiques mondiaux, de s’instruire aux questions d’armements, de comprendre les enjeux technologiques – extrêmement complexes - qui sont déjà les nôtres, de mieux comprendre la période d’incertitudes stratégiques dans laquelle nous sommes entrés.
C’est donc un livre indispensable pour qui cherche à comprendre notre monde contemporain.
Merci pour cet essai magistral.
Et comme il est d’habitude, je terminerai par quelques interrogations.
- Quels sont d’après vous les éléments qui caractérisent précisément la pensée chinoise ? les éléments qui fondent la pensée stratégique chinoise ?
-Quels sont les atouts et les déficiences de la pensée américaines et de la pensée européenne ?
- Vous affirmez que la confrontation est inévitable : quels seraient les éléments qui permettraient de l’éviter ? comment les mettre en œuvre ?
Enfin, nous devons vous interroger sur les politiques de défense en Europe, particulièrement en France :
- Est-il encore possible de penser une défense française autonome ?
- Si vous estimez que « non » - et notamment pour des raisons d’économie d’échelle - alors comment fait Israël ?
- Comment d’ailleurs refuser d’assurer notre défense alors que les américains se désengagent du théâtre européen ?
- Estimez-vous que la France est plus en sécurité aujourd’hui - après la réintégration du commandement militaire intégré de l’OTAN - qu’hier sous De Gaulle, quand nous l’avons quitté ?
- Enfin, pouvez-vous nous livrer vos analyses sur les attentats du 11 septembre 2001, et sur les actuelles crises Ukrainienne, syrienne … sur les interventions françaises en Libye ? au Mali ? en Centre-Afrique ?
Mon général, un grand Merci à vous.
Jean-Luc Pujo
Fin

